FONDATION DU MONASTÈRE A MADAGASCAR
- Martin M.
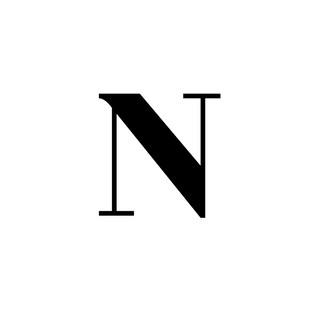
- 20 déc. 2022
- 12 min de lecture
Dernière mise à jour : 7 févr. 2023
Quelle est la raison pour laquelle le monastère de Nice a pris la décision de faire une fondation de sœurs clarisses à Madagascar.

Un peu d’histoire
L’île de Madagascar a pu commencer à être évangélisée, après que la colonisation française ait été établie avec ses bases de gouvernement et son armée pour la défendre. Auparavant il y a eu des reines successives qui avaient leurs dieux et n’en acceptaient point d’autres. Elles refusaient et persécutaient toutes personnes étrangères repérées. Saint Vincent de Paul avait envoyé six de ses fils, qui ont tous été tués. Plusieurs autres missionnaires y sont allés, avant et après, tous ont subi le même sort.
Avec la présence de la colonisation. Des maisons d’accueil ont été construites, les unes ont été utilisées par la suite comme écoles. D’autres qui au début étaient réservées pour soigner les colons malades ; ont été cédées par la suite aux gens du pays.
Lorsque la colonisation a été établie et respectée ; quelques envoyés du gouvernement français, sont allés en pleine nuit frapper à la porte du château de la Reine et l’ont embarquée avec toutes les suivantes qu’elle a voulu prendre avec elle, ainsi que les choses qu’elle a voulu emporter et les ont transférées à La Réunion. Peu de temps après, ces messieurs ont estimé qu’à La Réunion, la Reine et ses suivantes n’étaient pas assez éloignées de Madagascar n ils les ont amenées en France. Elles ont été casées dans un logement convenable, recevant régulièrement du gouvernement une pension pour pouvoir vivre et elles ont terminé leur vie en France.
A partir de ce moment, les missionnaires ont afflués librement à Madagascar, ainsi que des religieuses infirmières et d’autres religieuses éducatives. La langue française a été partiellement adapté, et l’organisation de la société pareillement. Durant un temps assez long ; français et malgaches vivaient ensemble, sans problèmes. Je ne puis fixer aucune date, n’ayant sous la main, aucun livre historique.
Présentation de la première jeune fille malgache ayant adoptée la vie des sœurs clarisses.
Elle naît dans le foyer de ses parents qui ont déjà une autre fille de quelques années. On nomme la deuxième : Jeanne D’Arc, mais au couvent on lui donne le nom de sœur Marie Claire. Quand cette deuxième fille eu 2 ou3 ans, ses parents se séparent. La coutume du pays étant qu’un enfant jeune, doit être avec sa maman, c’est donc avec sa maman que la petite jeanne D’Arc vit très heureuse jusqu’à l’âge de sept ans. A partir de ses sept ans son papa vient la chercher et la garde sous son autorité. Quand celle-ci eu l’âge d’une jeune fille, son papa voulut la marier. En général, ce sont les parents qui choisissent les futurs époux.Sœur Marie Claire nous a dit : « Un jour papa est venu à la maison et m’a dit que c’était le garçon qu’il avait choisi pour qu’il soit son mari. Ce garçon était presque aussi vieux que mon papa et j’ai dit non. Mais une jeune fille ne doit pas désobéir à son papa. Alors papa s’est mis en colère et a été méchant envers moi. Finalement il m’a chassé de la maison et je me suis retrouvée dans la cour évanouie.
Au bout d’un moment, j’ai repris conscience. Je me suis souvenue que papa m’a chassé de la maison ; alors j’ai pensé : « Où aller maintenant ? Eh ! bien, je vais aller à la Cathédrale et je mourrai là. Arrivée à la Cathédrale, toutes les portes étaient fermées à clef, c’était le soir, presque la nuit ; alors je me suis assise contre une porte et j’attendais la mort.
Et voici que peu après, le vicaire de la Cathédrale, fait le tour de la Cathédrale, avant de d’aller dormir. Il m’a vu et m’a dit : « Mais que faîtes-vous là ? » Je lui ai raconté mon histoire et il m’a dit. Je ne vous laisse pas là. Venez dans la voiture ; je vais vous conduire chez les religieuses qui prendront soin de vous. Ainsi fut fait. Ces religieuses m’ont soigné de leur mieux. Après ma guérison, j’ai travaillé chez elles, pour leur aider à soigner les personnes âgées en grand secret pour que papa ne sache rien.
Au bout d’un certain temps, j’ai manifesté mon désir de devenir religieuse. U frère franciscain, contacté par les sœurs de cette maison m’a conviée me disant que si je voulais devenir religieuse, il fallait sortir du pays pour faire ma formation à cause de mon papa. Il a contacté la communauté de Nice qui a répondu qu’elle m’accueillerait volontiers et ferait ma formation. Celle-ci me dit bientôt ceci : « Quand vous aurez fini votre formation nous irons avec vous à Madagascar et nous ferons une maison comme la nôtre. C’est ainsi et pour cette raison que la communauté de Nice s’était engagée à créer le 1er monastère malgache. Son adaptation en France, a dû se faire sans de sérieux problèmes. Les sœurs de Nice n’en ont jamais parlé. Après environ un an et demi de formation la Mère abbesse de Nice et la Mère maîtresse ont estimé que sœur Marie-Claire pouvait être admise à la prise d’habit, on lui demande son accord. Elle répond sans hésitation. Non, je ne peux pas, parce que papa est encore fâché contre moi, il ne me donnera pas sa bénédiction, alors je sais que ça ne marchera pas. Il faut que j’attende. Le contact avec sœur Marie Claire et son papa ne s’était pas encore manifesté, malgré le courrier envoyé régulièrement de Nice, le papa avait fait la sourde oreille. Mais voilà qu’une idée merveilleuse fut inspirée à Mère abbesse de Nice, c’est elle-même qui se charge d’écrire au papa, lui donnant clairement toute explication en lui promettant que lorsque sa fille aurait terminé entièrement sa formation religieuse un groupe de sœurs clarisses iraient à Madagascar et ferait construire un monastère comme celui de Nice et que sa fille serait la première sœur clarisse malgache ; quel grand honneur pour lui, ce serait. Cette fois-ci une réponse est arrivée, ainsi que la promesse d’une bénédiction pour la prise d’habit. Deo gratias !
Tout se poursuivit ensuite normalement. Les 3 ans de vœux temporaires étant achevés, on lui conseilla de les prolonger d’un an, au cours duquel nous allions travailler à la préparation d’un départ.
Il y eu une réunion pour les abbesses d’une fédération de monastères. Durant laquelle Mère de Nice exposa son projet et sollicita de l’aide de la fédération. Le monastère de Nice pouvait fournir seulement deux sœurs, le nombre fixé par Rome était de six. Il fallait que la fédération en trouve quatre. Peu à peu, le nombre de quatre fut atteint. Deux sœurs de Nantes, une de La Verdière et une autre de Vals-Les-Bains. En 1967 Mère abbesse de Nice et Mère Jean-Baptiste qui avait été la formatrice de sœur Marie Claire firent un voyage à Madagascar pour chercher un lieu d’implantation. Les sœurs Trinitaires de Tananarive, qui recueillent les enfants orphelins chez elles et leur donnent le couvert, l’alimentation et l’instruction gratuitement, ont reçu nos deux Mères et les ont accompagnés dans leur recherche, mais elles sont revenues sans avoir rien trouvé.
Quelques mois se passent et reçoivent un appel téléphonique de cette communauté de Madagascar pour leur dire que Mère supérieure s’est souvenu qu’un colon de Tananarive avait acheté du terrain du côté d’Antsirabé et accepterait de le revendre, à tel prix et ayant telle dimension. Nice répond : « Achetez et prenez tout. C’est ce qui fut fait. Mère abbesse de Nice venait d’hériter de ses parents, ce fut payé ainsi.
A présent, nous savions que c’était à Antsirabé que nous nous implanterions. Peu après, les Mères de Nice vinrent à Vals-Les-Bains pour faire le projet d’un premier départ avec deux sœurs. Ce fut le 20 octobre 1968 qu’elles prirent l’avion, les sœurs Trinitaires de Tananarive les ont accueillies à l’aéroport et conduites chez elles pour la nuit. Le lendemain Mère supérieure les a conduites elle-même à Antsirabé, au lieu qui à présent leur appartient. C’était un terrain inculte, à peu près plat qui se prêterait facilement à une construction. Il était situé en pleine compagne à deux ou trois kilomètres de la ville, mais facile à atteindre, car il y avait un chemin où pouvait passer une voiture jusqu’au bord où se trouvait ce lieu.
De là Mère supérieure, les conduisit chez les franciscaines missionnaires de Marie à Antsirabé, qui à leur tour les prennent en charge et leur sont très précieuses par la suite.
Le nombre de deux sœurs pour commencer était suffisant. Elles ont été logées et prises en pension, chez les sœurs bénédictines qui étaient organisées pour recevoir les sœurs missionnaires nouvellement arrivées à Madagascar, où se tenait un stage de formation de connaissance du peuple malgache, au point de vue coutumes et différentes choses pratiques, même une certaine connaissance de la langue, ce qui était très apprécié et les préparait à un apostolat fructueux. La formation commençait le 2 novembre et se terminait fin mai. La pension et la formation nous coûtaient assez cher.
Mère Jean-Baptiste était chargée de la responsabilité de la fondation. A Tananarive elle avait contacté un ingénieur français en vue des futures constructions. Elle a continué les contacts nécessaires, durant le temps où elle résidait à Ambasitra pour le temps de formation ? Donc, fin mai, notre future habitation était à peu près terminée, mais pas encore entièrement. Les ouvriers n’avaient pas quitté les lieux et faisaient les finitions.
Les franciscaines missionnaires de Marie, ont donc pris nos sœurs chez elles, jusqu’au jour où elles ont pu habiter notre maison.
Les quatre autres sœurs devaient arriver fin juin. Il fallait que Mère Jean-Baptiste aille à Tananarive pour les accueillir. Comme de coutume les sœurs Trinitaires accueillent chez elles, toutes ces arrivantes. Mère Jean-Baptiste désirait qu’avant de venir à Antsirabé, les nouvelles sœurs visitent la capitale, ce qu’elles firent durant plusieurs jours.
La compagne de Mère Jean-Baptiste avait depuis peu habité notre maison et commencé les grands ménages, les ouvriers venaient de partir. Elle serait volontiers restée seule pendant l’absence de Mère Jean-Baptiste, disant que pendant la journée frère Etienne travaillait à creuser le puits avec deux ouvriers, à environ 20 mètres de la maison. Le soir ils s’en vont, mais je n’aurais qu’à fermer toutes les portes à clef, alors que peut-il m’arriver. Mère Jean-Baptiste n’a pas été d’accord, alors une sœur franciscaine est restée avec elle. La sœur franciscaine était âgée, elle s’est occupée de la popotte et l’autre sœur a fait darre-darre les grands ménages, dans toute la maison. Ceci a fait il fallait à présent bourrer les paillasses qui avaient été cousues par la sœur durant son séjour chez les franciscaines. Il fallait faire vite et bien, afin que chaque chambre soit prête pour chacune et toutes. Et ce fut fini à l’arrivée de nos sœurs ; très vite la vie de communauté s’est organisée faisant face au plus pressé.
Aussi tôt que notre petite communauté fut arrivée et se trouvait au complet, Mère Jean-Baptiste se rendit à l’évêché à Antsirabé, lieu de résidence de l’évêque du diocèse, pour l’informer et l’inviter à nous rendre visite. Le jour en fut fixé, il prit tout son temps, pris son repas avec la communauté et nous avons pris une photo avec lui et la communauté.

La profession perpétuelle de sœur Marie-Claire fut fixée et célébrée peu après, dans la cour devant la maison, notre chapelle pouvant contenir très peu de personnes.
Mais auparavant le papa de sœur Marie-Claire fut contacté. Il invite toute la communauté à une réunion de famille où vivait la maman de sœur Marie-Claire et fit une grande fête. Il fut toujours très gentil pour la communauté et sœur Marie-Claire le retrouva peu à peu, avec une grande affection.
Après cela, la communauté s’organisa rapidement. La maison était neuve mais petite ; elle contenait toutes pièces nécessaires à la vie d’un petit nombre de personnes.
Commençons à parler de la chapelle. Elle réservait une place spéciale pour les sœurs, avec des bancs massifs en beau bois, le couvercle se soulevait, nous pouvions ranger nos livres, mais pour six sœurs seulement. Il y avait un minimum de séparation, pour la place des aspirantes avec des bancs plus légers. Et une toute petite place pour que le prêtre puisse revêtir les ornements pour la messe. L’autel était très bien disposé, il avait été rehaussé d’environ 15 ou 20 centimètres pour le mettre en valeur, en rehaussant le plancher ; en cet endroit tous les assistants pouvaient voir la célébration. L’autel, surtout les pieds étaient en beau bois. Mais notre tabernacle était un bijou ; tout entier en beau bois, sa porte était décorée avec l’arbre du voyageur. Une sœur avait capitonné à l’intérieur ; il avait une clef pour le fermer, ce qui était bien nécessaire, pour qu’un voleur ne vienne pas s’emparer du ciboire, car il y avait une porte qui donnait de ce côté et une personne pouvait entrer librement.
A côté du tabernacle il y avait un dispositif pour un lampion qui assurait la petite flamme traditionnelle.
Et maintenant les chambres. Lorsque nous étions à Ambositra chez les sœurs bénédictines, Mère supérieure nous dit de ne pas acheter de lit, qu’elles nous en donneraient ; la communauté en avait au galetas. Lorsque nous avons quitté Ambositra fin mai, nous avons contacté nos frères franciscains arrivés à Madagascar quelques années avant nous, pour leur demander de nous envoyer frère Etienne nous chercher et venir avec sa camionnette, afin d’y pouvoir charger tous nos lits. Il reste pour les voyageurs seulement deux sièges à l’avant, et nous étions trois. Un siège pour le conducteur qu’il fallait laisser à son aise, nous deux et un seul siège. Le voyage ne fut pas une promenade, mais enfin nous arrivâmes à destination sans avoir été malades. Les lits furent déchargés et transportés avec joie dans chaque chambre, autant qu’il en fallait. Ils étaient faits avec quelques planches reliées ensemble et quatre pieds ; c’était suffisant pour y déposer une paillasse. Et à cause d’un conseil d’une sœur Bénédictines, Mère Jean-Baptiste demanda à l’architecte qu’à chaque cloison d’une chambre à l’autre, il fasse faire aux maçons une place pour un placard, ce qui éviterait d’acheter un meuble. Cette idée fut très précieuse, ainsi chaque chambre eut son placard dès le début ; un menuisier fut contacté pour faire la partie qui le concernait. Voilà pour les chambres.
A présent il faut semble-t-il s’occuper de la cuisine. Ce sera vite fait en un premier temps. Dès le jour où la maison était habitée par les deux premières sœurs, il y avait ce qu’il fallait pour faire une soupe.
Je ne sais plus qui nous a prêté un petit poêle d’une hauteur de 40 ou 50 centimètres que les malgaches appellent un « Fatapera », il avait trois pieds en ferraille, ensuite une grille où l’on pouvait disposait brindilles de bois, quelques petites bûches ou bien un peu de charbon de bois, un vide au-dessus, puis une autre grille semblable à la première, où l’on mettait une marmite ou une casserole, mais non deux à la fois, la place aurait manqué. Et tout cuisait très bien, aussi bien que sur un fourneau. Ce poêle était posé devant la cuisine au grand air, le problème se posait seulement les jours de pluies, pour trouver comment l’abriter.
Cette façon de faire dura un temps assez long car les parents de la sœur de La Verdière, nous avaient donné un fourneau qui avait été endommagé durant le voyage en bateau, il attendait une réparation indispensable.
J’ai déjà parlé de frère Etienne creusant un puits, c’était indispensable car il n’y avait aucune source d’eau sur toute la partie de notre terrain. Nous avions un appareil à chasse d’eau des toilettes du rez-de-chaussée de notre maison, ainsi qu’à l’étage et des lavabos dans les chambres.
Où prendre l’eau ?
Je ne sais qui, a eu l’idée de faire le nécessaire pour que l’eau du puits puisse être conduite dans un réservoir au galetas de la maison, ensuite avec une installation et un robinet être déversée dans tel ou tel lavabos. Figurez-vous que cette idée fut fructueuse et fonctionna très bien il y avait pour la communauté une condition. Chaque sœur devait chaque jour, aller activer une pompe qui faisait monter l’eau, une pompe à bras, Mère Jean-Baptiste avait fixé le temps pour chacune, sœurs et aspirantes, 10 minutes chacune. Lorsque le réservoir du galetas ne donnait plus d’eau, quand nous ouvrions les lavabos ; elle venait nous dire : « qui n’a pas pompé aujourd’hui ; alors on entendait répondre : moi, moi, quelque fois c’était à peu près la totalité des personnes qui n’avait pas encore pompé. Alors, il fallait tout laisser et aller pomper durant 10 minutes et tout était réparé.
Que reste-t-il à voir au sujet de l’ameublement ?
Le parloir, le dortoir des aspirantes, la salle de communauté, le réfectoire de la communauté. Il n’y a pas grand-chose à dire.
Le parloir : Il est très petit. Une petite table suffit et trois sièges.
Le dortoir des sœurs. Il y a huit chambres. J’ai déjà dit qu’il y avait un placard dans chaque cloison fait par les maçons ; un lavabo, une petite table et un siège.
Celui des aspirantes.
Il me semble qu’il y avait que leurs lits. Pour la toilette, elles descendaient à la douche qui se trouvait proche des toilettes.
Le réfectoire des sœurs ; un placard pour ranger la vaisselle nécessaire, ce placard avait aussi été préparé par les maçons sur un mur de cloison ; un tout petit lavabo dans un coin de mur, une table pour six personnes, et autant de sièges.
La salle de la communauté est plutôt grande, avec deux grands placards pour ranger le linge et les vêtements en réserve, et aussi des restes de tissu pour travailler. Toute cette précaire installation dura six ou sept ans environ ; au bout de ce temps on commença à parler de faire une grande chapelle indépendante de la première maison, mais pas loin, et plutôt à côté. Nous pourrions ainsi accueillir des personnes des alentours, et surtout la communauté serait moins à l’étroit pour les offices au chœur. La petite chapelle de la première maison, ferait une pièce supplémentaire à transformer peut-être pour agrandir la cuisine. On commença à faire des plans qui aboutirent en chantiers, après un temps d’attente assez long.
Avec le développement progressif du noviciat et des premiers engagements des aspirantes primitives, il était évident que la première maison ne suffirait bientôt plus à l’habitation quotidienne. Il fallait penser à en construire une autre, reliée à la première. Cela se fit lentement mais obligatoirement.
Peu à peu, avec le temps, on pensa à un poulailler, à une écurie pour les bœufs et les vaches, et même pour élever des porcs. Nous eûmes des ouvriers pour le travail.
J’arrête là, l’histoire de la fondation. Aujourd’hui il y a cinq monastères de sœurs clarisses, répartis dans la grande île, aucune sœur française ne s’y trouve. Chacune est revenue dans son monastère d’origine, en raison de santé ou d’âge pour les dernières. Il y en trois qui sont décédés, sur le nombre des six premières.
Je souhaite une longue persévérance à nos sœurs et à la continuité de l’exemple de leur vie donnée, à la suite de notre Mère sainte Claire, pour l’amour du Chris.
Sœur Marie Joseph COMTE, une des six sœurs fondatrices
Monastère Sainte Claire Vals-Les-Bains.
19 avril 2020



Commentaires